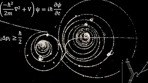C'est comment, un monde sans avion ?
#3 : Où l'on imagine le monde de demain


Bonjour bonjour !
J’espère que vous pardonnerez ce titre quelque peu aguicheur, mais l’histoire qui suit est réellement une variation fictionnelle autour de cette question : comment on vit dans un monde où il n’est plus possible de prendre l’avion d’un bout à l’autre de la planète ? Quelles incidences sur nos destins ?
Fini les petites souris et les ados dans leur manoir hanté. Le personnage d’Eduardo, le héros dont vous allez suivre les questionnements dans cette lettre et la suivante, est au départ un personnage secondaire d’une autre histoire à laquelle j’ai commencé à penser un peu avant le confinement de 2020, mais qui n’est pas encore aboutie, et qui ne le sera peut-être jamais. Pourtant, il y a quelques temps, j’ai eu envie de développer un texte plus court autour de ce héros involontaire, de cet anti-héros. Le recul de quelques années m’a permis de réaliser à quelle vitesse évolue le monde, comment ce qui paraissait invraisemblable à la fin 2019 n’est peut-être plus si dystopique, comment tout semble se précipiter.
Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une bonne lecture de la première partie ! Pensez à vous abonner pour ne pas rater la deuxième et dernière partie.
Si vous avez envie de lire en musique, cliquez là pour ma recommandation : https://open.spotify.com/intl-fr/track/2HWtJWJww2PlLOlgwdPLKH?si=3f14f24546324671
crédit photo : Warka Water / photographe : Arturo Vittori
______________________________________________
Mon nom sur la liste - partie 1/2
- I -
Assis dans la salle d'attente, je scrute depuis plusieurs minutes les pales du ventilateur qui tournent sans agitation. Autour de moi, les chaises installées le long des murs sont vides. Sur la table basse au pied cassé, plusieurs prospectus officiels rappellent les démarches administratives qu’on peut faire sur place. Je les regarde sans les voir. Il n’y a pas d’horloge dans la pièce, comme si on voulait masquer toute trace de l’attente. Au bout d'un moment, mon nom est enfin appelé. J'entre dans la petite pièce que je connais bien, avec ses murs d’un beige poussiéreux, une affiche délavée sur les techniques de préservation de l’eau et la petite fenêtre qui donne sur la rue, deux étages plus bas. Je m’installe face au bureau délabré. Si la pièce n’a pas changé, la personne devant moi en revanche est plus jeune et moins assurée que les fonctionnaires auxquels j’ai affaire d’habitude. La jeune femme me fait signe de prendre place face à elle, regarde son écran d’ordinateur, puis demande d’une voix automatique :
— Nom, prénom ?
— Goya, Eduardo.
— Nationalité ?
— Chilienne.
— Date de naissance ?
— 17 décembre 2000.
— Âge ?
— Vous ne pouvez pas calculer ?
— Âge, s’il vous plaît ? reprend-elle sans même lever les yeux.
Je réponds d’un ton presque aussi mécanique :
— Quarante-cinq ans.
— Merci. Destination souhaitée pour le vol ?
— Santiago, Chili.
— Nombre de demandes préalables ?
— 26.
À ma réponse, elle arrête de pianoter et lève les yeux vers moi, tentant de masquer sa surprise. Elle fait ce qu’elle peut pour rester présentable mais son chemisier froissé et les perles de sueur sur le haut de son front la trahissent. L’air de mai est déjà étouffant dans son bureau mal aéré. C’est toujours à ce moment de l’enregistrement que le ton devient plus empathique :
— La vache ! Mais vous faites votre demande depuis combien de temps ?
— Depuis le début, depuis 18 ans.
— Et vous n’avez jamais été sélectionné par le programme ?
— Non.
— Ben, c’est vraiment pas de bol quand même ! Enfin, vous avez du mérite de continuer à demander. Allez, courage, cette fois, ce sera peut-être la bonne.
Cela fait un bon paquet de fois que mon entretien de demande de vol vers mon pays d’origine se termine par cette petite phrase. J’ai appris à ne pas y attacher trop d’attention et à renvoyer un signe poli au sourire un peu peiné de l’employé de bureau qui me reçoit.
J’ai répondu aux dernières questions, donné tous les documents nécessaires en me demandant encore une fois pourquoi ils ne gardaient pas tout ça dans leurs archives ou dans un cloud comme à l’époque. Peut-être une façon de décourager quelques candidats de plus. Puis, je me suis levé pour aller reprendre le car vers mon village. Alors que j’avais la main sur la poingée, la jeune femme m’a interpellé :
— Ah, monsieur Goya, attendez.
Je me suis retourné tandis qu’elle refermait sa gourde d’un geste sec. Elle avait à peine eu le temps de boire une gorgée d’eau et essuyait un filet d’eau le long de sa lèvre.
— J’ai une notification sur votre page. Il semble que vous ayez une lettre qui vous attende au service courrier. Deuxième étage, couloir D, porte 34.
Surpris et intrigué, je suis allé chercher mon pli. Je n’ai pas reçu de lettres depuis des années, encore moins de mails. La lettre venait de mon pays. Je l'ai ouverte en tremblant un peu, entre excitation et inquiétude. Son contenu m’a plongé dans une confusion brumeuse.
Par la fenêtre du car, sur le chemin du retour, je regarde le paysage sans le voir, cette lettre serrée fort dans ma main. La climatisation fonctionne mal, mais en ce tout début de l’après-midi, il n’y a pas grand monde pour s’en plaindre. Mes mains moites commencent à faire déteindre l’encre du papier blanc.
Le car roule en silence, nous passons le long des champs de maïs et de panneaux solaires. Il ne va pas vite. Personne n’est pressé et vu l’état de la petite route, il vaut mieux éviter de prendre trop de vitesse. Le soleil est haut dans le ciel et les nuages sont absents depuis plusieurs jours. Devoir s’arrêter pour changer une roue sous ce cagnard, ce serait internal. Autrefois, quand le revêtement de l’autoroute n’était pas complètement défoncé, le trajet se faisait en une demi-heure tout au plus entre le centre-ville et le village. Mais personne n’a entretenu l'autoroute et maintenant, il faut au moins le triple du temps.
Au loin derrière les champs, j’aperçois les trois tours de récupération d’eau qui indiquent ma destination. Encore un petit quart d’heure et je serai rentré. Combien de fois ai-je fait ce trajet ? Vingt fois ? Trente fois ? Cent fois ? Depuis le blocage des trajets aériens, depuis que je suis coincé ici, les années semblent s’étirer comme des siècles et je suis perdu dans ce temps ralenti.
À la descente du bus, Leslie est là, comme à chaque fois. Elle a interrompu son travail en cuisine pour m’accueillir et faciliter mon retour. Ça me soulage d'avoir un peu de compagnie pour rentrer, même si je n'ai pas envie de parler. En plus, je l'aime bien, Leslie. Elle a tout juste vingt ans, elle ne dit pas grand chose mais elle sait capter les besoins des autres et se décarcasser pour leur rendre la vie plus douce. Quand elle ne tend pas la main pour vous aider à vous relever, elle s’assoit à vos côtés pour vous prêter une oreille.
— Salut Eduardo. Alors, demande envoyée ?
— Eh oui, une fois de plus. Ne dis rien, s’il te plaît
— Mais je n’allais rien dire, répond-elle d’un sourire malicieux. Sinon t’annoncer que nous mangerons des galettes de maïs avec de la salade ce soir. On sera nombreux, il y a pas mal de réservations.
Nous marchons en silence vers le centre du village. À cette heure, les enfants comme les parents finissent la sieste avant de reprendre leurs activités d’extérieur. Peut-être que ceux qui s’activent en intérieur ont déjà repris, à la blanchisserie par exemple. Avec la climatisation et le linge frais qui circule, c’est plus facile.
Nous pénétrons dans le bâtiment central. Autrefois, c’était juste la mairie. Les gens y venaient pour faire une demande de papiers, pour se marier devant un élu qui les connaissait à peine ou pour râler après un trou dans la chaussée, rien de plus. Avec la mise en place de notre petite communauté, il y a bientôt quinze ans, c’est devenu un lieu de vie, d’échanges, un lieu central où l’on discute des réalisations à venir, où l’on célèbre ensemble les moments de joie comme les grandes peines, où l’on peut même, parfois, entendre un concert. Une partie du lieu a été aménagée en un grand espace de repas, une sorte de cantine pouvant accueillir tout le monde.
Leslie avance d'un pas déterminé jusqu'à la cuisine, son repère, d'où elle sort tous ses trésors des multiples placards et dessertes qui s'y trouvent. Sur le grand plan de travail en inox, au centre de la pièce, s’étalent les caisses remplies d'épis de maïs en train d'être égrenés pour ce soir.
La jeune fille ouvre un petit placard en bois dans un coin de la pièce, s'agenouille pour fouiller à l'intérieur et finit par en sortir un sachet de papier kraft qu'elle pose devant moi avec un grand sourire. Ses tresses blondes sont entortillées sur le haut de son crâne et lui donnent un air malicieux.
— J'ai réussi à en récupérer un peu, je les ai mis de côté pour toi, explique-t-elle en ouvrant le sachet. Je me suis dit que ça te ferait du bien après cette matinée de démarche.
L'odeur suave du café emplit mes narines et m'apporte un peu de joie.
— Va t'asseoir si tu veux, pendant que je le prépare, reprend Leslie, le moulin à café dans la main.
Je continue vers la grande salle à manger et m’installe à ma table préférée, la petite en bois dans le coin le plus éloigné de la fenêtre. Après un temps, c’est un café bien fort servi dans un tout petit verre transparent que m’apporte Leslie. Elle s’assied ensuite sur la chaise opposée pour me regarder le boire.
Je déguste sans un mot en scrutant le liquide noir. Je ne veux pas croiser les yeux verts et plein d’espoir de Leslie. Quelle que soit la situation, elle est toujours si enthousiaste, alors que moi, je suis tellement résigné. Sans ses encouragements, j’aurais abandonné depuis un bout de temps. Mais elle est là, à chaque fois, à chaque demande et son énergie m'empêche de baisser complètement les bras. Elle ne peut pas me comprendre, mais elle me soutient et cette présence-là, à ce moment-là, est précieuse.
— Je dois repartir en cuisine, Eduardo, annonce-t-elle en posant sa main sur mon avant-bras. Allez, ça va aller. Il faut y croire. Toujours. Ça va arriver.
— T’as raison, Leslie, je le sais bien. Mais c’est dur. De plus en plus dur.
— Il n’y a pas de raison que ça n’arrive pas. À chaque sélection, il y a des milliers de personnes qui peuvent prendre l’avion. Un jour, ce sera ton tour.
— Mais ça fait 18 ans que j’attends, Leslie. Tu sais ce que ça représente, 18 ans ? C’est presque ton âge. Je m’acharne depuis des années, j’ai fait 26 demandes et toujours sans succès. Si mon nom se sort pas cette fois-ci, j’arrête, c’est définitif.
— Aussi loin que mes souvenirs remontent, je t'ai toujours entendu dire ça, répond-elle en se levant dans un rire salutaire. Allez, je retourne nous faire un repas, sinon j’ai trente-huit personnes qui vont râler ce soir !
Je finis ma tasse dans le calme de la salle à manger commune. Plus jeune, j’aimais tellement boire du café, sous toutes ses formes. Expresso, café frappé, afogato, l’amertume qui me tapissait la bouche m’emplissait chaque fois de satisfaction douce. Celui-ci a un goût de passé révolu.
Je repense à la lettre, dont le papier gondole au fond de ma poche. Ma gorge se serre comme rarement. D’un geste brusque, je repousse la chaise et me lève. Il faut que je vois Julia.
- II -
Je traverse la rue principale au moment où les enfants retournent à l’école. Ils sont une dizaine, joyeux, vifs, à courir et chahuter sur le chemin. L’enfance semble demeurer cet espace de la joie et de l’insouciance, malgré le chaos du monde extérieur, malgré le peu de perspectives attrayantes. Il faut reconnaître que ces bambins n’ont jamais connu que cette vie-là, comment pourraient-ils regretter un monde moins chaud et plus connecté ?
Arrivé en bas de l’immeuble de Julia, je grimpe l’escalier qui mène à sa chambre. Porte et fenêtres sont grandes ouvertes, pour tenter de faire circuler le moindre souffle de vent. Julia est devant sa toile, un pinceau à la main. Ses lourds cheveux noirs sont relevés haut sur la tête et elle ne porte qu’un débardeur et un short de toile, que des gouttelettes de peinture ont tachés à de multiples reprises.
Je m’appuie au chambranle pour la regarder en silence. Sa chambre est grande, avec trois hautes fenêtres sur la façade est. Le lit collé contre le mur du fond et les draps en pagaille. Sur des chaises, des vêtements froissés, des livres de toutes sortes, trois ou quatre gourdes émaillées et partout des cahiers ouverts avec des bouts de texte, de dessins, d’idées griffonnées à la va-vite ou bien détaillées minutieusement. Posés contre le mur opposé, les tableaux déjà peints ou en cours d’achèvement et sur le chevalet, celui qui a sa faveur ces jours-ci. Depuis la porte, je vois mal ce qu’il représente. De toute façon, je sais que quelque soit mon interprétation, elle aura autre chose à faire dire à son œuvre. Son bras couvert de tatouages variés va et vient entre la toile et le tabouret sur lequel est posé la palette. Il n’est pas facile de trouver du matériel pour peindre de nos jours. Je lui ai déjà préparé quelques toiles en clouant des draps épais sur des cadres, tandis qu’elle testait des mélanges de pigments, naturels ou non, avec diverses huiles en quête de la couleur et de la viscosité parfaites.
Cela ne suffit pas toujours mais Julia sait user de toutes ses ressources pour obtenir ce dont elle a besoin, ses tubes de peintures, ses pinceaux, sa farouche indépendance.
Elle a du me voir arriver dès le début, mais elle me laisse le temps de faire le tour de son univers en apposant encore quelques traces de couleur. Puis elle m’interpelle :
— Alors, revenu de ton périple à l’administration centrale ? Tu n’as pas été happé par la machine ? demande-t-elle en riant.
Elle comprend à mon air renfrogné que je ne suis pas d’humeur. Je m’approche d’elle, la gorge encore nouée malgré la satisfaction de la revoir.
— C’est une de ces fois où tu reviens plus triste que nourri d’espoir, j’ai l’impression, dit-elle en posant son pinceau à côté d’elle
— Je me sens tellement fatigué, Julia, tellement démuni.
Je pense à la lettre dont je voulais lui parler, mais je ne sais par quels mots commencer.
Je m’approche un peu plus. Sur la toile, un cheval d’or semble se débattre dans une mer déchaînée, pleine d’écume argentée. Julia se colle à moi, sa main caresse ma joue puis elle m’embrasse profondément. La caresse de son corps m’apaise un peu. Je pose mon front contre le sien, respire plus doucement.
Sans plus de mot, Julia s'agenouille devant moi, défait ma ceinture. Mon souffle s'interrompt au contact de ses lèvres.
Déstabilisé, je dois m'appuyer sur le tabouret à côté de la toile. Ma main s'écrase sur la palette de peinture. Des tâches épaisses de bleu, de doré, d'argenté maculent mes doigts.
Quand Julia se relève, elle observe ma main tachée, la saisit doucement et appuie son visage à l'intérieur. Je ferme les yeux. Cela a toujours été ainsi entre nous. Pas de sentiment, pas de fidélité mais une réponse charnelle tendre et délicieuse à nos plus sombres malheurs.
- III -
Je suis rentré chez moi rapidement. J'avais besoin de retirer cet ersatz de costume porté uniquement pour paraître digne auprès des services de l'administration.
J'ai remis mon bermuda et un t-shirt élimé encore à peu près présentable. Je suis assis dans mon éternel fauteuil au milieu de ma chambre et je regarde sans le voir mon costume qui gît en boule au sol.
Ma tête est vide. Ou plutôt ma tête est tellement pleine d’un marécage d’idées poisseuses et n’arrive pas à y voir clair.
J'ai quitté mon pays il y a dix-huit ans, en 2026 ou 2027, je ne me souviens plus très bien. Je fuyais une femme que je n'aimais plus et un destin que je n'avais pas envie d'embrasser, assoiffé de voyages, de rencontres, de liberté. Le monde ne tournait déjà pas bien rond mais je ne voulais pas m'en rendre compte. Peut-être que le début de ma jeunesse, fauché par des mois de confinement plusieurs années auparavant, m'avait laissé un vide, ou une envie débordante d'aventures, de découvertes, d’ailleurs.
Je suis parti sans me retourner, sans regret, jusqu'à la nouvelle épidémie, celle qui a une nouvelle fois tout bloqué. Frontières fermées, vols interdits, monde en sursis.
Mais à l’inverse du covid de 2020, rien n'est revenu à la normale. Les dictatures étaient plus fortes, les catastrophes plus nombreuses, les États plus méfiants. Après quelques mois de crise absolue s'est mis en place ce système débile de tirage au sort pour les vols long-courrier. Cent mille places à chaque fois, à une fréquence que personne ne comprend. Vous vous enregistrez sur la liste, et vous attendez que votre nom sorte. Pas d'autre solution, point de non retour atteint. Ce fut le choc. Des scènes extrêmement violentes ont eu lieu au moment des premiers départs. Des gens se précipitaient par dizaines dans les aéroports et sur les tarmacs, la réponse des autorités était sanglante.
Puis, au fil des mois, des années, on s'est résigné, on a accepté ce bête système de loterie. Le nombre de demandes est resté très élevé pendant quelques années puis n'a cessé de diminuer. Aujourd'hui, les avions sont tout juste remplis. La résignation l’a emportée, le monde a changé.
J'étais en France à ce moment-là, je n'ai pas quitté le pays depuis. J'ai tenté à chaque fois d'avoir une place, j'ai toujours fourni le plus sérieusement possible tous les documents nécessaires, mais jamais mon nom ne s'est trouvé sur la liste.
Ce n'est pas tant que je voulais retrouver les miens mais l'idée de ne plus jamais retourner dans mon pays me paraissait angoissante. Comme si le fait de ne pouvoir le faire rendait encore plus forte l’envie de rentrer.
J’ai continué à voyager, ou plutôt à errer sur les routes jusqu’à ce que je rencontre Thibaud, dans un bar bordelais, un de ces endroits cachés où on pouvait encore écouter de la musique live. Il m’a eu à la bonne et m’a tout de suite parlé de la communauté où il vivait, à quelques kilomètres de là. En moins de dix jours, j’étais installé dans cette chambre et on m’avait trouvé un rôle comme mécanicien. C’était il y a quatorze ans.
J’en suis là de mes réflexions, à ressasser l’historique de mes demandes de vol, à me demander pourquoi ce n’est jamais tombé sur moi. Je voudrais rester prostré sur ce fauteuil jusqu'à ce que le monde finisse de s'effondrer mais Julia frappe à ma porte.
— Eduardo, c'est l'heure d'aller manger.
Je sais qu'elle ne me laissera pas rester seul, qu’elle va rester plantée sur le seuil de la chambre jusqu'à ce que je me lève pour l’accompagner. Elle a tressé ses cheveux pour essayer de les dompter pourtant ils continuent de s’échapper et de former une auréole noire et vaporeuse autour de son visage. Elle a troqué les vêtements recouverts de peinture pour une robe verte à fleurs que je lui ai toujours connue.
— Allez, debout. On y va.
Nous nous sommes assis à une des petites tables du fond de la salle à manger commune, où Thibaud nous a rejoint comme il le fait quatre soirs par semaine. Autour de nous, les tablées sont nombreuses, les conversations se multiplient et le bruit permet de masquer notre silence.
Leslie et ses acolytes s'activent à droite à gauche pour le service, font circuler des plats remplis d'épis de maïs ou des carafes d’eau, rapportent les plateaux laissés par les familles ayant terminé leur repas plus tôt. Il y a dans l’air quelque chose de joyeux, le frémissement de la rumeur d’une fête, qui tranche avec la tension à notre table.
— Tu finis pas ton assiette ? m'interroge Thibaud.
— Non, vas-y. Je n'ai pas très faim.
Je lui tend mon plat d'un geste lent. Attentive à l'incompréhension dans le regard de Thibaud, Julia précise :
— Eduardo est allé déposer sa demande de vol aujourd'hui.
— C'est pour ça que tu tires cette tête depuis le début du repas ?
— Oui. Ça me décourage un peu plus à chaque fois.
— Mais pourquoi tu t'entêtes à demander à la fin ? T'es pas bien ici ? Franchement, tout est facile, tellement plus simple qu’avant. On vit tous ensemble, chacun a une place, on fait pousser ce qu'on mange, on construit ce dont on a besoin, tout le monde a un toit, personne manque de rien. T'as pas beaucoup d'amis mais c'est que tu parles pas beaucoup non plus. Et puis, t'as Julia. Tout le monde sait que c'est toi qu'elle préfère.
Celle-ci esquisse un demi sourire d'aveu.
— Je suis bien ici, c'est pas le problème. Je voudrais juste revenir chez moi, retrouver mes racines. Je suis parti il y a dix-huit ans. Dix-huit ans, tu te rends compte de ce que ça représente ? Je suis parti pour des raisons pas forcément valables, je te l'accorde. Mais je pouvais pas savoir que le monde changerait à ce point ! Qu’on vivrait toutes ces crises, toutes ces violences ! Je pouvais pas savoir que toutes les liaisons aériennes seraient coupées comme ça, d'un coup. Qu'on serait obligé de passer par ce logiciel à la con pour espérer avoir un vol. Ça fait 18 ans que j'attends que mon nom sorte ! Chaque refus me tue un peu plus à chaque fois.
— Tu connais mon point de vue sur la question, mec. Pour moi, t'es hors jeu. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que t’as fait, mais je suis sûr qu'ils t'ont black-listé. Arrête de t'acharner, tu t’en porteras mieux.
— Ne lui plombe pas le moral comme ça, Thibaud. Ce n'est pas le jour, intervient Julia d’une voix calme.
— Leslie dit qu'il faut insister, que la sélection est complètement aléatoire et qu'un jour mon nom sortira.
— Mais qu'est-ce qu'elle y connaît Leslie ? me coupe Thibaud. Elle a jamais quitté la ville. C'est une gosse, elle a l'âge d'être ta fille.
À ces mots, la colère me saisit. Je balance le plateau devant moi et me lève violemment. Deux verres se renversent. L’eau se répand sur la table, sur leurs jambes, sur le sol.Je me mets à crier :
— Tu peux pas comprendre, Thibaud. C’est tout ce qu’il me reste, cet espoir. Rentrer, retrouver mon pays, ma maison, mes origines. Toi, t’es né à cinquante kilomètres d’ici, t’as jamais voyagé à plus de 200 bornes. Toute ta vie est à portée de ta main. T’étais avec tes parents quand ils sont morts. Les miens, ils sont morts sans savoir si j’existais toujours, j’étais trop loin, trop seul. Alors oui, s’il ne me reste qu’un stupide algorithme auquel m’accrocher, je m’y accroche.
Tous les regards de la salle se sont tous tournés vers moi, même Leslie au loin. Je tourne les talons, franchis la sortie de secours et presse le pas. Dans l’air chaud du soir, j'entends Julia derrière moi. Sa main attrape mon bras, me retourne.
— Eduardo, attends. Ne pars pas comme ça. Il s’y prend mal mais tu sais qu’il dit ça pour te secouer, te remonter le moral.
D’un geste sec, je m’arrache de son étreinte.
— J’ai pas besoin de ses commentaires, j’ai pas besoin qu’on me remonte le moral, de quelque façon que ce soit. Je veux juste….
Ma voix tremble.
— Je veux juste qu’on me laisse tranquille.
Partir vite. Retrouver mon appartement, mon fauteuil, mes restes d’illusions. Je sens sur mon dos le regard vexé de Julia. Dans ma poche, mon poing serré froisse un peu plus le courrier reçu ce matin.